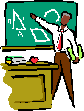
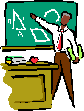 |
|||
| ... | |||


LANGEVIN PAUL (1872-1946)
Physicien français né et mort
à Paris.
«J’ai grandi au lendemain de
la guerre de 1870 entre un père républicain jusqu’au fond de l’âme et une
mère dévouée jusqu’au sacrifice, au milieu de cet admirable peuple de
Paris, dont je me suis toujours senti si profondément solidaire. Mon père qui
avait dû, malgré lui, interrompre ses études à l’âge de dix-huit ans,
m’a inspiré le désir de savoir; lui et ma mère, témoins occulaires du siège
et de la sanglante répression de la Commune, m’ont, par leurs récits, mis au
cœur l’horreur de la violence et le désir passionné de la justice sociale»
(Paul Langevin, 1945).
Très jeune, Paul Langevin
manifeste des dons exceptionnels, sanctionnés par une carrière scolaire qui
sort de l’ordinaire; encouragé par ses instituteurs, il parcourt rapidement
les divers échelons de l’enseignement primaire, puis primaire supérieur,
avant d’entrer à seize ans à l’École supérieure de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris (seule école d’ingénieurs accessible à
ceux qui n’avaient pas reçu l’enseignement des lycées). Langevin y suit
les cours et l’enseignement de laboratoire de Pierre Curie, avec lequel il se
lie d’amitié. À sa sortie de l’École, il renonce à la carrière d’ingénieur
et décide, sur les conseils de Pierre Curie, de se consacrer à la recherche et
à l’enseignement. Aussi, se présente-t-il à l’École normale supérieure:
il est reçu premier en 1894. En 1897, il bénéficie d’une bourse pour aller
travailler un an au Cavendish Laboratory de Cambridge, haut lieu de la science
européenne où se trouvent alors E. Rutherford et J. J. Thomson. De retour
en France, il soutient sa thèse en 1902, est nommé professeur suppléant, puis
professeur au Collège de France. En 1904, il succède à Pierre Curie à l’École
de physique et de chimie, dont il devient directeur en 1925. Langevin, on le
voit, est l’exemple même de ces «enfants du peuple» dont l’avenir a été
entièrement façonné par l’école de la IIIe République.
Au moment où Paul Langevin
entame sa carrière scientifique, en 1895, la physique est à un tournant de son
histoire. L’œuvre de Langevin se situe dans cette longue période de
transition qui, de 1900 à 1930, mène de la physique «classique» à la
physique «moderne», dominée par la théorie de la relativité d’Einstein et
la théorie quantique. Ses premiers travaux (sur l’ionisation des gaz) l’amènent
à s’intéresser au problème de la nature microscopique du magnétisme. Il élabore
un modèle dans lequel les électrons à l’intérieur des atomes décrivent
des orbites fermées, conférant ainsi aux atomes des propriétés analogues à
celles de petits aimants. Du fait de leur interaction électromagnétique, ces
petits aimants auraient tendance à s’aligner parallèlement les uns aux
autres, n’était l’agitation thermique qui tend à leur donner des
directions aléatoires; les propriétés magnétiques d’un corps résultant
alors de la compétition entre un facteur d’ordre (l’interaction électromagnétique)
et un facteur de désordre (l’agitation thermique). Cette théorie, élaborée
en 1905, devait par la suite servir de modèle à de nombreuses autres
explications des propriétés macroscopiques de la matière, faisant toutes
intervenir les effets statistiques combinés de facteurs d’ordre et de désordre.
En 1906, alors qu’il
travaille à l’élaboration d’un cours sur la théorie électromagnétique,
professé au Collège de France, Langevin aboutit au résultat étonnant selon
lequel l’inertie serait une propriété de l’énergie..., du moins dans le
cas de l’électron. Ce n’est que quelques mois plus tard qu’il lira le mémoire
d’Einstein sur la théorie de la relativité restreinte. Il en saisira immédiatement
toute la portée révolutionnaire: «Ce véritable sens n’était rien moins
qu’une conception nouvelle et relative du temps [...] opposée à la
conception ancienne du temps absolu dépourvue de base expérimentale» (P.
Langevin, notes sur des travaux scientifiques, 1934). Dès lors, tout en
contribuant à l’approfondissement des concepts de la théorie, il va se
consacrer à l’enseignement et à la divulgation de ces idées nouvelles, que
ce soit dans ses cours au Collège de France, ou en des lieux moins
conventionnels, telle la Société française de philosophie. En 1922, il fait
venir Einstein à Paris pour une série de conférences. Ce voyage, que des
nationalistes anti-allemands tentèrent d’empêcher (au point que le quartier
Latin fut à cette occasion mis en état de siège), marque une étape
importante dans le long combat que mena Langevin pour l’introduction des idées
«relativistes» en France.
L’activité internationale de
Langevin ne se limite pas là. Il est à l’origine des fameux congrès Solvay
qui, dès 1911, réunirent périodiquement tous les grands noms de la physique,
et où furent largement discutés les concepts de la théorie quantique. C’est
d’ailleurs grâce à lui que les travaux de son élève Louis de Broglie sur
la mécanique ondulatoire connurent la diffusion qu’ils méritaient: d’abord
étonné, Langevin fut très vite convaincu de la justesse des idées de De
Broglie et inscrivit immédiatement la nouvelle mécanique ondulatoire au
programme de son cours au Collège de France. Fidèle à l’idéal de clarté pédagogique
qui fut toujours le sien, Langevin a par ailleurs effectué, sur les concepts
encore en gestation de la théorie quantique, un travail d’analyse et de
refonte épistémologiques dont on mesure aujourd’hui l’importance.
L’enseignement, de façon générale,
a tenu une place de premier plan dans sa vie. Il n’a cessé d’enseigner au
Collège de France; mais aussi en toutes sortes de lieux scolaires ou
para-scolaires: à la section des électriciens de l’Association
philotechnique (sorte de cours du soir), à l’École de physique et de chimie,
à l’École normale supérieure de Sèvres — où il fut maître de conférences
de 1905 à 1930, à une époque où l’enseignement féminin (surtout
l’enseignement scientifique) constituait un réel enjeu politique —, à l’Université
ouvrière (autre enjeu politique), en compagnie de Romain Rolland et de Henri
Barbusse, et finalement, de façon bénévole, à l’École normale
d’institutrices de Troyes où il fut assigné à résidence durant la Seconde
Guerre mondiale.
Son œuvre scientifique et son
travail d’enseignant ne sauraient être dissociés de son engagement
politique. Homme de gauche, militant pacifiste et antifasciste — il est à
l’origine de la création du Comité de vigilance des intellectuels
antifascistes, plus connu sous le nom de Comité Amsterdam-Pleyel —, résistant
durant l’occupation allemande, Langevin n’a cessé de payer de sa personne.
Il était convenu que la diffusion des idées scientifiques et la science elle-même
ne peuvent que contribuer au bonheur de l’humanité, et que la science était
un facteur essentiel de l’évolution de la société, de la paix sociale et
internationale. Soucieux de «construire un homme nouveau», Langevin n’a cessé
de plaider pour une transformation de l’enseignement, dans un sens qui ferait
aux disciplines scientifiques une part égale à celle qui est réservée aux
traditionnelles humanités. C’est dans cet esprit qu’il élabora, pendant la
Seconde Guerre mondiale et après la Libération, un plan de réforme de
l’enseignement, en collaboration avec le psychologue Henri Wallon: le plan
Langevin-Wallon. Ce plan qui, entre autres choses, préconisait la réduction
des effectifs des classes est à l’origine de certaines des réformes de
l’après-guerre; il a durablement servi de référence aux partis de gauche.
___________________________________
© 1997 Encyclopædia Universalis France S.A.Tous droits de propriété intellectuelle et industrielle réservés.